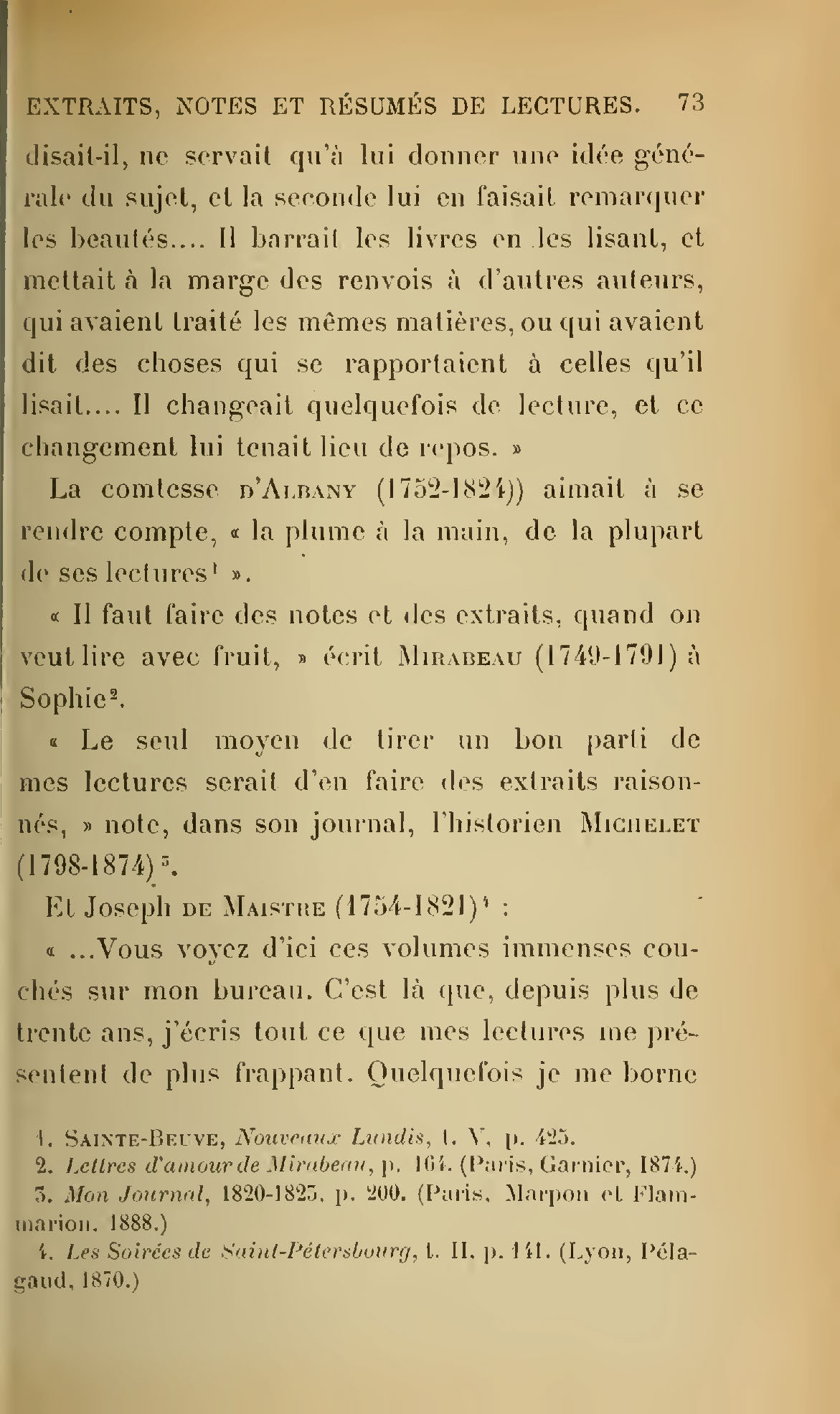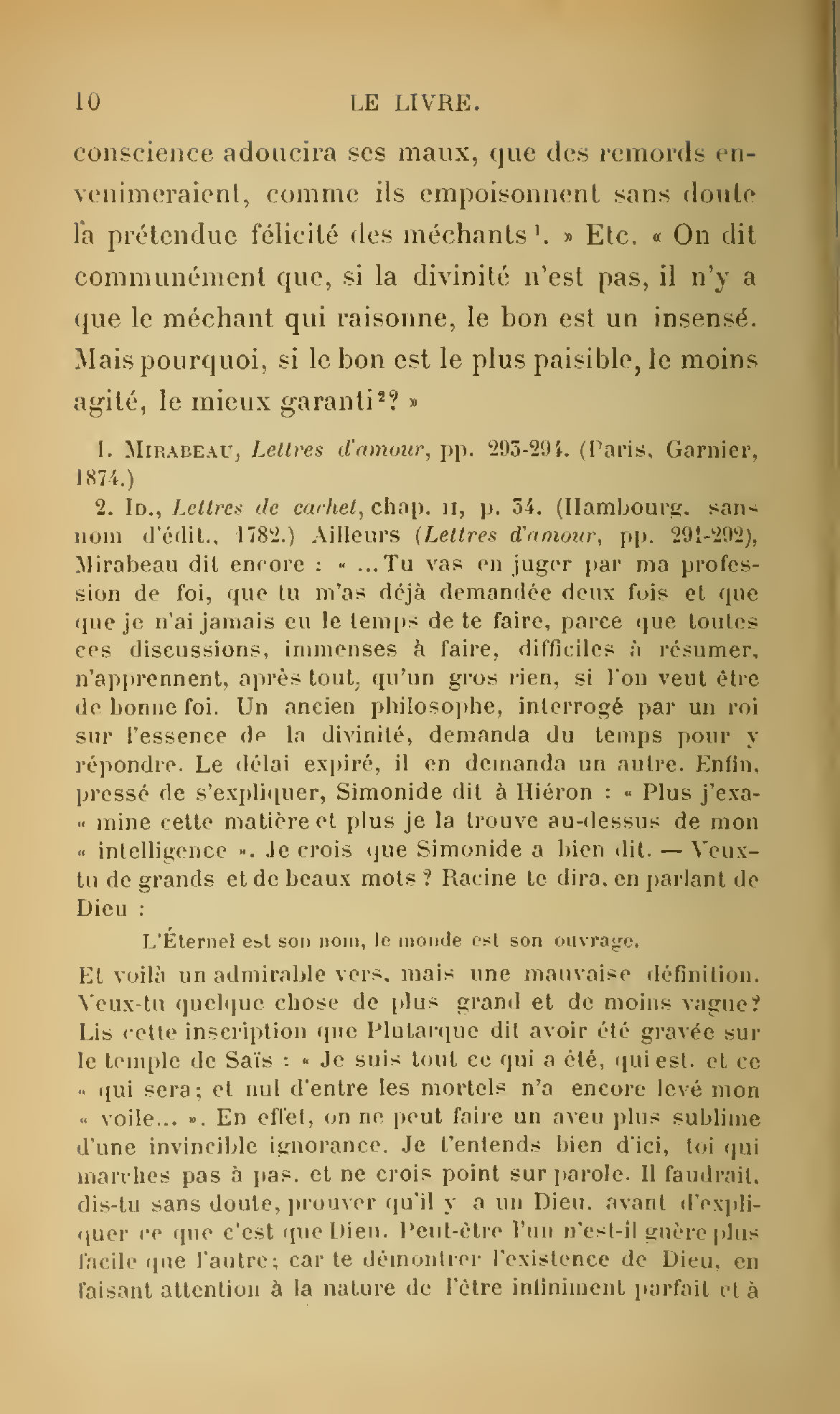la gardienne de la liberté, la presse gênée en est le fléau. L’opinion publique, voilà le seul juge compétent des opinions privées, le seul censeur légitime des écrits…. La liberté de la presse n’inspire de terreur qu’à ces gens usurpateurs d’un crédit et d’une considération de mauvais aloi, forcés de s’avouer intérieurement combien leur est nécessaire l’ignorance publique. »
Mirabeau (1749-1791) proclame de même que « c’est la liberté de la presse qui est le palladium de toutes les libertés[212.1] ».
Sieyès (1748-1836) pareillement : « Point de liberté publique et individuelle sans la liberté de la presse[212.2] ».
« Le grand remède de la licence de la presse est dans la liberté de la presse, déclare Camille Desmoulins (1762-1794)[212.3] ; c’est cette lance d’Achille qui guérit les plaies qu’elle a faites. »
« La presse est une nécessité sociale plus encore
- Mirabeau, Adresse aux Bataves, xxvi : Mirabeau, sa vie, ses opinions et ses discours, par A. Vermorel, t. II, p. 159. (Paris, Bibliothèque nationale, 1865.) ↩
- Ap. Eugène Dubief, le Journalisme, p. 304. (Paris, Hachette, 1892 ; Bibliothèque des Merveilles.) ↩
- Le Vieux Cordelier, nº VII : Œuvres, t. III, p. 152. (Paris, Bibliothèque nationale, 1869.) Dans ce même numéro du Vieux Cordelier (p. 119), Camille Desmoulins cite cette maxime de Sylvain Bailly, le maire de Paris (1736-1793) : « La publicité est la sauvegarde du peuple ». ↩